Le Conseil d’Etat a répondu à mon interpellation concernant l’emploi de travailleurs temporaires.
Pour télécharger la réponse (en pdf), cliquer ici
Un commentaire détaillé suivra.

Le Conseil d’Etat a répondu à mon interpellation concernant l’emploi de travailleurs temporaires.
Pour télécharger la réponse (en pdf), cliquer ici
Un commentaire détaillé suivra.
La société de recouvrement intrum justicia, qui fait pourtant commerce des difficultés de paiement, tire aujourd’hui la sonnette d’alarme: les jeunes sont de plus en plus touchés par le surendettement. Ce constat n’est malheureusement pas nouveau et l’on sait que c’est bien souvent la collectivité qui doit payer les pots cassés, lorsque les familles surendettées sont mises à l’aide sociale. Et la crise du crédit privé qui s’annonce aux Etats-Unis laisse augurer que cela pourrait devenir bien pire encore.
Pourtant, il est très difficile, voire impossible, de faire passer des mesures pour limiter les risques d’endettement. Ainsi, le canton refuse de faire appliquer l’interdiction de la publicité pour le petit crédit (crédit à la consommation), dont on connaît pourtant les dégâts. Le parti socialiste et les associations de défense des consommateurs continuent à se mobiliser.
Pire, les propositions pour aggraver l’endettement des jeunes et des familles ne manquent pas. Dernière en date, le projet de la conférence des directeurs cantonaux de l’instruction publique d’accord intercantonal sur les bourses d’études, qui fait la part belle au remplacement des bourses par les prêts, remplissant ainsi une des revendications de longue date des milieux économiques. Qui devraient pourtant bien se rendre compte qu’il est difficile de fonder une famille ou une entreprise lorsqu’on achève ses études avec des dettes de plusieurs dizaines de milliers de francs. Ou que la perspective de l’endettement découragerait bien des jeunes issus des familles modestes de se former. Et que la situation actuelle de l’endettement des jeunes devrait amener à faire des propositions plus raisonnables.
Demain, le canton inaugure dans la liesse le métro M2. Parmi le concert (justifié) des louanges et des superlatifs, difficile de trouver une voix discordante. Même les opposants de naguère semblent être devenus des partisans convaincus (il faut dire qu’il y a de quoi s’enthousiasmer!). Et pourtant.
Souvenons-nous des débats qui précédèrent le vote des vaudoises et vaudois. Charles Favre, alors conseiller d’Etat responsable des finances, avait proposé posé cette condition, qui s’apparentait à une forme de chantage: « pas de M2 sans vente des actions de la BCV » (« 24 heures » d’hier le rappelle dans le portrait de Philippe Biéler qui n’est pas disponible en ligne). Le grand argentier radical n’acceptait la réalisation d’un des chantiers majeurs du service public vaudois qu’à condition de privatiser la banque cantonale. Il se servait ainsi abusivement d’un projet nécessaire au développement du canton pour faire passer en force une idée néolibérale. Quelques années et trois votes populaires plus tard, Vaud inaugure son métro avec fierté (même si la voie unique entre gare et Grancy démontre à quel ridicule peut mener l’orthodoxie budgétaire), la banque cantonale est restée majoritairement en mains publiques suite à la victoire du référendum socialiste… et Charles Favre n’a pas été élu au conseil des Etats, entraînant la perte d’un siège que les radicaux considéraient pourtant comme leur.
Hier soir, le conseil communal de Riex a malheureusement accepté d’autoriser la municipalité à combler le probable déficit budgétaire 2009 par la vente d’action de la CVE-Romande Energie. Ce faisant, il menace le maintien en mains publiques de notre compagnie d’électricité, malgré le fait que les géants européens de l’énergie lorgnent sur ses actions, avides qu’ils sont non pas d’assurer l’approvisionnement en électricité des habitants et PME de notre canton, mais de faire main basse sur nos barrages et nos réseaux électriques. Je me suis opposé à cette vente d’actions.
Certes, ce ne sont pas les 0,01% du capital que possède Riex qui feront la différence. Certes, la situation financière de la commune est difficile et un déficit est presque inévitable. Mais ce serait le premier en plus de 10 ans, la commune a une assise financière solide (c’est l’ancien membre et président de la commission des finances qui parle), n’a presque pas de dette et dispose de réserves importantes (supérieures au montant que l’on pourrait tirer de la vente des actions). En outre, il est encore trop tôt pour dire si le déficit sera de nature structurelle, donc récurrent, ou seulement ponctuel. Il n’est donc pas nécessaire de vendre les actions de la CVE, même si leur prix élevé les rend particulièrement alléchantes. Car si toutes les petites communes se mettaient à vendre leurs actions, la CVE risquerait de se retrouver rapidement en mains privées et nous perdrions le contrôle démocratique sur l’approvisionnement en électricité, ainsi que sur les prix.
Riex doit participer à la solidarité intercommunale
L’avis de la municipalité, bien qu’elle se prétende opposée à la privatisation, était que Riex «est trop petite et possède trop peu d’action pour garantir à elle seule le service public». Mais si toutes les communes font ce raisonnement, elles risquent toutes de vendre! C’est ce qu’ont compris 170 communes, qui ont signé avec l’Etat et la BCV une convention d’actionnaires visant au maintien en mains publiques de la CVE grâce à des droits de préemption à prix préférentiel. Elles ont bien compris que l’adage «l’union fait la force» n’est pas qu’un slogan creux et que, s’il est exact que seules elles ne peuvent rien, unies, elles ont une force de frappe non négligeable (les communes disposant de 13% du capital action, elles peuvent faire pencher la balance en faveur des collectivité publiques). La municipalité s’est malheureusement opposée à une adhésion de Riex à cette convention, pour des raisons assez absurdes. Là encore, elle pense que Riex seule «ne peut rien faire et ne doit pas se lier les mains», alors que le but de la convention est justement d’unir les force des communes pour qu’elles ne soient plus seules! Le but de la convention est aussi d’instaurer une solidarité entre les communes, afin que toutes fassent ensemble le sacrifice de ne pas vendre des actions dont le prix est pourtant très intéressant. Malgré l’opposition de l’exécutif, ma proposition d’adhésion à la convention a été transmise à une commission. Le feuilleton des actions de la CVE n’est donc pas encore clos.
«Vous n’avez pas une idée d’une école où je pourrai inscrire ma fille l’an prochain? L’école publique de mon quartier n’a plus un rond et en plus, elle est pleine de pauvres et d’étrangers…». «Mon fils va à l’école primaire de Ste-Croix, on y apprend le swahili dès la 2ème! Et 50Km aller-retour tous les jours, ce n’est pas si terrible. Et le chèque scolaire couvre tous les frais d’essence.». «Moi, je mets le mien à la A-One-Education. Pratique, c’est à côté de mon bureau; je le dépose le matin et le reprends le soir». «Vous devriez penser à la pré-business school of Peney-le-Jorat. Leurs uniformes sont signés des plus grands couturiers. En plus, si les parents sont actionnaires, leurs enfants ont une bonne note supplémentaire par mois!». «Et pourquoi pas l’école coranique d’Yverdon? Elle est sortie en tête du dernier ranking.» «Et de toute façon, si ça vous plaît pas et si les enseignants ne font pas exactement ce que vous voulez, vous pouvez changer chaque année!» «Vous devriez faire comme moi. Cela fait 10 ans que tous mes enfants vont à la elite&smart boarding school of St Sulpice. Le standing y est toujours aussi élevé, mais maintenant, grâce au chèque scolaire, on nous paie pour y aller.»
Chronique de politique chronique parue dans le Tromblon.
Ces derniers jours, j’ai été plusieurs fois abordé à la gare de Lausanne par des étudiant-e-s qui tentaient de faire adhérer les passantes et passants à moult œuvres dites de bienfaisance pour le compte d’une entreprise spécialisée dans le démarchage «jeune et sympa», genre corris. On y entend de tout. De l’obséquieux «bonjour, jeune homme» au faussement familier «salut chef!». Ces récolteurs de fonds sont bien gentils, bien rodés et ont réponse à tout. A ma question «êtes-vous membre de l’association à laquelle vous voulez me faire adhérer», la réponse fuse sans hésitation: «bien sûr, depuis trois ans». Vu l’âge de celle qui me répondait, j’ai eu un peu de peine à le croire. Mais bon, après tout, pourquoi pas. En tout cas, j’ignorai que «save the children» (ou quelque chose comme ça), une association dont je n’avais jamais entendu parler auparavant, avait autant de militant-e-s. D’ailleurs, les récolteurs semblent aussi s’étonner d’apprendre que les organisations pour lesquelles ils recrutent ont déjà des membres. Ainsi, lorsqu’on me demande un autre jour «tu es déjà membre d’amnesty international?» (le tutoiement semble de rigueur) et que je réponds «oui» (même si amnesty ne paraissait pas enchantée que je le fasse savoir), on me rétorque «vraiment?» d’un ton incrédule et sur l’air du «c’est ce qu’ils répondent tous». Et le récolteur de fonds d’insister pour me faire remplir un bulletin. Heureusement, à la gare, la bonne excuse du train à prendre marche à tous les coups.
Ces méthodes de pseudo-militantisme sont agaçantes. Et elles se répandent de plus en plus, même pour l’exercice des droits populaires. Ainsi, on apprenait récemment («24heures» du 4 août, l’article n’est plus en ligne) que les opposants à un nouveau musée des beaux-arts pour tous les vaudois ainsi que les partisans de l’initiative pour l’épargne-logement avaient rémunéré des «militants» à la signature. Si même les initiatives et référendums s’achètent… Et, à force, les organisations qui les emploient risquent de perdre toute crédibilité et surtout toute capacité d’action.Car la force d’une association, ce sont d’abord ses militant-e-s qui portent son message et ses valeurs. Les remplacer par des donateurs recrutés à la sauvette remplira peut-être leurs caisses, mais ne leur donnera aucun poids.
Aujourd’hui, au grand conseil, la majorité de droite a réussi à réintroduire et à alourdir en 2ème débat (voir le récit du 1er débat) les allègement fiscaux en faveur des gros actionnaires des grandes entreprises, pourtant refusés à 54% par le peuple vaudois en février dernier. Elle n’avait qu’un seul argument: «les autres cantons se sont adaptés, alors nous sommes obligés de s’adapter aussi, nous n’avons pas le choix». Les décisions ne se prennent donc plus à Lausanne, mais dans les autres cantons. Bel exemple de souveraineté.
Au cours du débat, la majorité de droite a aussi plusieurs fois admis que la réforme profite surtout aux grandes entreprises, alors que, durant la campagne en vue de la votation fédérale, promis, juré, on ne nous parlait que des PME. Mais, aujourd’hui, il ne s’agit plus d’être favorable aux PME, mais surtout d’empêcher un «exode fiscal» des grandes entreprises. Exode fiscal dont au demeurant personne ne peut démontrer l’existence.
Et les familles, dans tout ça?
On s’en souvient, le paquet fiscal vaudois avait été enrobé de mesures en faveur des familles, pour que la pilule des cadeaux fiscaux aux gros actionnaires passe plus facilement. En premier débat, un amendement socialiste beaucoup plus favorable aux familles modestes et de la classe moyenne avait été accepté. En deuxième débat, la majorité de droite l’a malheureusement emporté et l’amendement a été refusé. Il faut aussi signaler une tentative des verts d’augmenter les déductions fiscales en faveur des familles à hauts revenus. Une fois de plus, le ni-à-gauche-ni-à-droite penche plutôt à droite.
Au final, le grand conseil a choisi de privilégier sciemment les gros contribuables aux dépens des familles. Peut-être reviendra-t-il à de meilleures dispositions en 3ème débat.
Les tricheurs peuvent toujours courir…
Mais ce n’est pas tout: La majorité de droite a ensuite refusé un postulat du groupe socialiste demandant une augmentation du nombre d’inspecteurs fiscaux pour lutter contre la fraude et la soustraction fiscale. Pas sûr que la population, qui paie ses impôts honnêtement (elle ne le fait peut-être pas toujours de gaieté de coeur, mais elle le fait), apprécie qu’on se désintéresse pareillement de la triche.
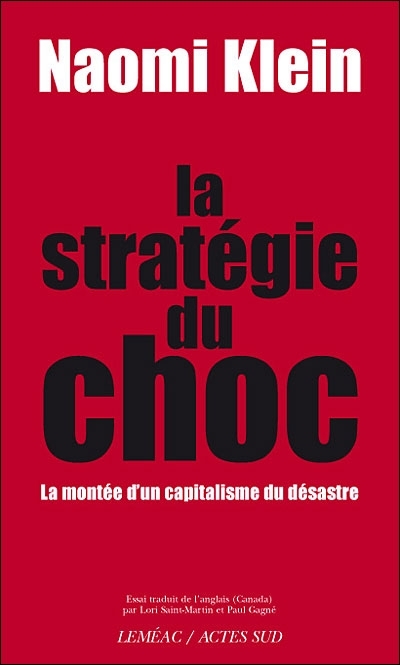 L’auteure du best-seller «no logo» s’attaque à Milton Friedmann et à l’école de Chicago. Avec une thèse qui fait froid dans le dos. Ces ultralibéraux sont en effet conscients que leurs thèses ne peuvent qu’être impopulaires, tant elles visent à limiter l’Etat à une portion congrue et à rogner au maximum sa marge de manoeuvre, à privatiser le plus de services publics possibles (le mieux étant des les vendre à des multinationales), tâches régaliennes (notamment la sécurité publique) incluses et à jeter par dessus-bord législation de protection des travailleurs et assurances sociales. Puisqu’ils ne peuvent guère les imposer dans les urnes, ou dans ce cas devoir faire face à un mécontentement populaire justifié, ils en sont réduits à devoir profiter d’une «crise» ou d’un «choc» violent dont la principale qualité est de réduire à néant la capacité de réaction des élus et des populations, qui sont alors «mûrs» pour accepter, ou se faire imposer n’importe quoi. Une crise peut être une catastrophe naturelle, un bouleversement politique ou économique (p. ex. une crise monétaire), mais aussi une guerre, souvent un coup d’Etat. Après la crise, les néolibéraux pensent disposer d’une «page blanche» pour réformer l’Etat à leur manière. Et la crise a brisé toute résistance.
L’auteure du best-seller «no logo» s’attaque à Milton Friedmann et à l’école de Chicago. Avec une thèse qui fait froid dans le dos. Ces ultralibéraux sont en effet conscients que leurs thèses ne peuvent qu’être impopulaires, tant elles visent à limiter l’Etat à une portion congrue et à rogner au maximum sa marge de manoeuvre, à privatiser le plus de services publics possibles (le mieux étant des les vendre à des multinationales), tâches régaliennes (notamment la sécurité publique) incluses et à jeter par dessus-bord législation de protection des travailleurs et assurances sociales. Puisqu’ils ne peuvent guère les imposer dans les urnes, ou dans ce cas devoir faire face à un mécontentement populaire justifié, ils en sont réduits à devoir profiter d’une «crise» ou d’un «choc» violent dont la principale qualité est de réduire à néant la capacité de réaction des élus et des populations, qui sont alors «mûrs» pour accepter, ou se faire imposer n’importe quoi. Une crise peut être une catastrophe naturelle, un bouleversement politique ou économique (p. ex. une crise monétaire), mais aussi une guerre, souvent un coup d’Etat. Après la crise, les néolibéraux pensent disposer d’une «page blanche» pour réformer l’Etat à leur manière. Et la crise a brisé toute résistance.
Continuer la lecture
Mardi prochain, le grand conseil vaudois se prononcera sur l’initiative contre la fumée passive. Et sur le contre-projet. La minorité de la commission, dont je suis rapporteur (le rapport de minorité en pdf ), préconise d’accepter l’initiative plutôt que ce dernier. En effet, le contre-projet a de nombreux défauts, notamment sur deux sujets qui me sont chers: la protection des travailleurs et des jeunes.
Les fumoirs prévus par le contre-projet ne protègent pas efficacement le personnel des cafés. Ils sont certes censés être « sans service », mais cet état de faits sera difficile à contrôler et à faire appliquer. On peut aussi redouter que les patrons incitent leur personnel à s’y rendre quand même, par exemple grâce au très efficace couplet « il y en a des tas qui seraient ravis d’avoir ton emploi… ». En outre, construire des fumoirs totalement hermétiques n’est peut-être techniquement pas possible: des fumées pourraient alors se répandre dans la partie non-fumeurs des établissements. Enfin, même dans le cas où les fumoirs seraient étanches et réellement sans service, le personnel chargé de les nettoyer serait tout même exposé à la fumée et aux particules fines qui y abondent.
Les fumoirs du contre-projet auraient aussi une mauvaise influence sur les efforts de prévention déployés envers les jeunes. Si l’on veut empêcher qu’ils commencent à fumer, il faut réduire les incitations (lieux où l’on peut fumer) au maximum. Créer des fumoirs va certainement à l’encontre de cette stratégie.
Enfin, des lieux 100% sans fumée tels que le préconise l’initiative sont le moyen la plus efficace pour la prévention du tabagisme. C’est en tout cas l’avis des spécialistes de la question. Et ce quoiqu’en pense GastroVaud, qui a tenté, dans une lettre aux députés, de faire croire que le responsable du CIPRET-VD, le Dr Cornuz, était partisan du contre-projet – soutenu par GastroVaud – au moyen d’une citation erronée et sortie de son contexte. Ce que le CIPRET et le Dr Cornuz ont démenti dans une lettre de rectification (Rectificatif du CIPRET.pdf) envoyée à tous les députés. GastroVaud, qui s’est signalée à maintes reprises par ses tactiques dilatoires pour torpiller l’interdiction de fumer dans les lieux publics, ne sait décidément plus quoi inventer.
Le grand conseil débattait cet après-midi du paquet fiscal du gouvernement, comprenant, en vrac, des mesures (soutenues par le PS) pour les familles modestes et de la classe moyenne, quelques adaptations techniques incontestées, l’introduction d’un «bouclier fiscal» pour les hauts revenus et l’introduction de la réforme de l’imposition des entreprises II dans la législation vaudoise. Ce joli paquet joliment ficelé n’a qu’un objectif: faire avaler une pilule que les vaudoises et les vaudois ont pourtant nettement refusé dans les urnes en février dernier. Pourtant, à entendre la plupart des intervenants bourgeois, ceux-ci sont intimement convaincus que ces mesures sont bonnes pour l’emploi et les PME. En outre, nombreux furent ceux à prétendre que, depuis l’acceptation de la réforme au niveau fédéral et sa mise en application dans la quasi-totalité des cantons, les circonstances ont à ce point changé et la concurrence intercantonale à ce point augmenté que, cette fois, les vaudois accepteraient probablement la réforme si elle leur était à nouveau soumise.
Il n’en demeure pas moins que la majorité bourgeoise a maintenu le principe du paquet et refusé de scinder les lois, ce qui aurait permis un vote populaire séparé sur les objets. Vote que la majorité semblait pourtant sûre de remporter. Mais puisqu’elle a maintenu le paquet, c’est donc qu’elle n’est pas si convaincue que cela par ses propres arguments. Ou alors, c’est qu’elle les sait erronés, voire mensongers.