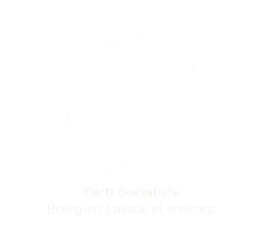Ça devient une manie. Investir des milliards de fonds publics pour sauver une entreprise privée de la débâcle où l’avait plongé la seule incompétence de ses managers néolibéraux, puis s’en désengager le plus rapidement possible. Sans avoir ne serait-ce que tenté d’exercer la moindre once d’influence, ni fait usage des droits que pourtant chaque investisseur mettant de telles sommes sur la table n’aurait de cesse d’exiger (en appliquant, lui, le slogan «qui paie commande»).
Il y a d’abord eu Swissair, dont le sauvetage – ou plutôt l’atterrissage un peu moins brutal que si on avait laissé faire le marché – a coûté 2 milliards de francs. Socialisation des pertes. L’on s’est ensuite empressé de céder à bas prix la compagnie qui lui a succédé à Lufthansa, pour que ce soit cette dernière qui encaisse les premiers profits. Privatisation des bénéfices.
Et voilà que ça recommence avec UBS. Plusieurs dizaines de milliards dépensés en quelques heures, pas le moindre début d’une volonté de veiller à ce que la banque utilise à bon escient l’argent public en ne retombant pas dans ses travers de course effrénée aux risques et aux boni, puis revente la plus rapide possible, avec pour seul argument que l’Etat n’a pas à détenir des participations dans le secteur privé. La revente dégage cette fois un petit bénéfice, certes, mais sans garantie qu’une nouvelle intervention publique au secours de la banque ne sera pas nécessaire d’ici quelques mois (intervention dont la probabilité sera d’autant plus élevée si – hors de tout contrôle public – UBS recommence à jouer au casino). Comme si l’idéologie néolibérale n’avait pas fait assez de dégâts ces derniers temps…