 L’auteure du best-seller «no logo» s’attaque à Milton Friedmann et à l’école de Chicago. Avec une thèse qui fait froid dans le dos. Ces ultralibéraux sont en effet conscients que leurs thèses ne peuvent qu’être impopulaires, tant elles visent à limiter l’Etat à une portion congrue et à rogner au maximum sa marge de manoeuvre, à privatiser le plus de services publics possibles (le mieux étant des les vendre à des multinationales), tâches régaliennes (notamment la sécurité publique) incluses et à jeter par dessus-bord législation de protection des travailleurs et assurances sociales. Puisqu’ils ne peuvent guère les imposer dans les urnes, ou dans ce cas devoir faire face à un mécontentement populaire justifié, ils en sont réduits à devoir profiter d’une «crise» ou d’un «choc» violent dont la principale qualité est de réduire à néant la capacité de réaction des élus et des populations, qui sont alors «mûrs» pour accepter, ou se faire imposer n’importe quoi. Une crise peut être une catastrophe naturelle, un bouleversement politique ou économique (p. ex. une crise monétaire), mais aussi une guerre, souvent un coup d’Etat. Après la crise, les néolibéraux pensent disposer d’une «page blanche» pour réformer l’Etat à leur manière. Et la crise a brisé toute résistance.
L’auteure du best-seller «no logo» s’attaque à Milton Friedmann et à l’école de Chicago. Avec une thèse qui fait froid dans le dos. Ces ultralibéraux sont en effet conscients que leurs thèses ne peuvent qu’être impopulaires, tant elles visent à limiter l’Etat à une portion congrue et à rogner au maximum sa marge de manoeuvre, à privatiser le plus de services publics possibles (le mieux étant des les vendre à des multinationales), tâches régaliennes (notamment la sécurité publique) incluses et à jeter par dessus-bord législation de protection des travailleurs et assurances sociales. Puisqu’ils ne peuvent guère les imposer dans les urnes, ou dans ce cas devoir faire face à un mécontentement populaire justifié, ils en sont réduits à devoir profiter d’une «crise» ou d’un «choc» violent dont la principale qualité est de réduire à néant la capacité de réaction des élus et des populations, qui sont alors «mûrs» pour accepter, ou se faire imposer n’importe quoi. Une crise peut être une catastrophe naturelle, un bouleversement politique ou économique (p. ex. une crise monétaire), mais aussi une guerre, souvent un coup d’Etat. Après la crise, les néolibéraux pensent disposer d’une «page blanche» pour réformer l’Etat à leur manière. Et la crise a brisé toute résistance.
Et Naomi Klein de faire la liste des «crises» qui permirent d’imposer les thérapies de choc ultralibérales préconisée par l’école de Chicago (privatisation, libéralisation, ouvertures des marchés), souvent dans l’illégalité, voire la violence : Le Chili, où il fallu la dictature de Pinochet (Naomi Klein en profite pour brise le mythe du prétendu «miracle économique chilien» que l’on devrait à Pinochet, et à ses Chicago Boys) pour casser le modèle keynésien en train d’être mis en place. L’Argentine et sa junte. Mme Thatcher, qui profita de la guerre des Malouines pour imposer ses réformes néolibérales. L’Afrique du Sud et la fin de l’apratheid. La Russie et la Pologne et l’effondrement du communisme. Diverses crises monétaires, souvent provoquées par le FMI, infiltré jusqu’à la moëlle par l’école de Chicago. Le tsunami au Sri Lanka, dont on se servit pour exproprier les villages côtiers en vue d’y construire des complexes touristiques de luxe. L’ouragan Katrina, auquel ne purent faire face des services publiques déjà trop amaigris et une aide d’urgence privatisée qui se souciait surtout de rebâtir les beaux quartiers. Cet ouragan est d’ailleurs un excellent exemple de comment imposer la privatisation de l’éducation en servant d’une situation de crise: avant la tempête, la quasi-totalité des écoles étaient publiques. Après, presque toutes étaient des écoles privées subventionnées («à charte»).
Mais attendre la crise ne suffit plus, les nouvelles crises sont sciemment provoquées: la guerre en Irak, apogée de la guerre privatisée, en est un exemple frappant. La guerre moderne n’est plus nuisible à l’économie, au contraire. Elle permet de créer de nouveaux marchés: Armées privées, services logistiques aux armées, reconstruction, privatisation des anciens services d’Etat, mesures de sécurité intérieure. Sécurité que l’Etat, devenu trop svelte, n’est plus en mesure de garantir, pas plus que la reconstruction, d’ailleurs. Naomi Klein détaille certaines des entreprises qui gravitent autour des ministère de la défense: Halliburton, Blackwaters, etc. Et qui y sont parfois si bien implantées (leurs lobbyistes sont parfois ministres, Donald Rumsfeld étant l’exemple le plus connu) qu’elles s’en servent pour déclancher les guerres qui les nourriront de contrats.
Très bien documenté, «la stratégie du choc» comporte quelques citations qui font froid dans le dos. Ainsi, telle ministre de la junte argentine (Magruerite Feitlowitz, citée en page 138) qui justifie la torture et les assassinats dans l’idée de briser la résistance aux réformes économiques. Et tant pis si des innocents en sont morts. Ou tel Chicago boy (Sergio de Castro, cité en pages 138s) vantant la «fermeté» du général Pinochet. Ou John Williamson, économiste connu pour ses travaux en faveur de la création des institutions de Bretton Woods, pour qui «on peut se demander s’il y aurait lieu de songer à provoquer délibérément une crise pour supprimer les obstacles politiques aux réformes» (p. 310). Ou Michael Bruno, économiste en chef à la banque mondiale, pour qui les organisations internationales ne devraient pas se contenter d’attendre les crises pour en profiter, mais supprimer l’aide à titre préventif afin qu’elles s’accélèrent (p. 314).
La croisade néolibérale n’est pas prête à prendre fin. Le secrétariat d’Etat étasunien à la défense a créé un bureau de la reconstruction et de la stabilisation (office of reconstruction and stabilization), qui paie des entreprises pour élaborer des plans de reconstruction tous prêts, pour les pays auxquels Oncle Sam prévoit de s’en prendre, l’Iran, le Vénézuéla, etc. Les pré-contrats sont déjà signés. Un nouveau modèle de guerre et de reconstruction privatisée semble prendre forme. Et puisque la guerre semble, contrairement à ce qui se passait il y à quelques années, au moins aussi profitable à l’économie mondiale que la paix, il n’y a plus aucun scrupule à avoir.
Le livre de Naomi Klein comporte quelques défauts. Il s’égare parfois dans des digressions inutiles et se perd quelques fois dans les détails. Mais il n’en demeure pas moins une lecture indispensable. En tout cas à tous ceux qui croient en l’Etat et la démocratie. Une lecture en forme d’avertissement.
Naomi Klein, La stratégie du choc, Actes Sud – Leméac 2008 (The schock doctrine, Toronto 2007), 670p.

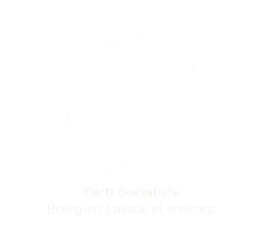
Et si vous lisiez une fois autre chose que vos traditionnelles rengaines collectivistes. Car jusqu’à preuve du contraire, les pays capitalistes fonctionnent nettement mieux que les pays socialistes, non? Ou niez-vous la réalité de l’histoire?
Rassurez-vous, je lis régulièrement des ouvrages traitant du droit de la concurrence.
Qu’entendez-vous par « pays socialistes »? Si vous voulez parler des pays ex-communistes, je partage votre avis. Mais j’insiste sur le mot « communiste ». En revanche, je ne pense pas que des pays qui bénéficient d’une forte protection sociale, p. ex. les pays nordiques, aillent moins bien que les pays les plus libéraux…