Le projet de révision de la loi sur la poursuite pour dette et la faillite (LP) doit faciliter l’assainissement des entreprises, afin d’éviter autant que possible les faillites. Cet important chantier est ouvert depuis l’affaire «swissair», soit plus d’une décennie. Il pourrait permettre une avancée sociale majeure, pour laquelle les socialistes se sont battus depuis des années, mais contient une pilule très amère pour les salariés. Le conseil fédéral propose en effet d’introduire enfin l’obligation de négocier et de conclure un plan social dans les grandes entreprises. Mais il propose aussi – c’est le revers de la médaille – de supprimer l’obligation pour le repreneur d’une entreprise en faillite de reprendre tous ses salariés, laissant le choix audit repreneur de choisir les salariés qu’il réengage.
Plans sociaux: progrès social
L’obligation de négocier et de conclure un plan social dans les grandes entreprises peut être considéré comme un progrès social important. Comme de nombreux progrès sociaux en Suisse, il a d’abord été expérimenté avec succès grâce aux conventions collectives de travail. Plusieurs d’entre elles prévoient en effet une obligation de négocier, plus rarement de conclure un tel plan, qui doit permettre d’atténuer la rigueur d’un licenciement collectif, soit en sauvant des emplois, soit en prévoyant des mesures pour les salariés qui perdront le leur (reclassement, indemnités de licenciement, formation, retraites anticipées). Malheureusement, en l’absence d’obligation de négocier (ou de conclure la négociation), bien des entreprises en bonne santé restructurent sans scrupules pour augmenter les bénéfices distribués aux actionnaires (et le bonus des managers), laissant des dizaines de salariés sur le carreau, sans la moindre sanction légale. L’exemple actuel de Merck-Serono, qui annonce des centaines de licenciements malgré d’énormes bénéfices montre que ce genre de pratique n’est pas rare en ces temps où la «shareholder value» est portée aux nues.
La proposition du conseil fédéral est minimale: elle ne s’applique en effet qu’aux entreprises de 250 salariés au minimum (soit 0,37% des entreprises et environ un tiers des salariés). Lors des débats au Conseil des Etats, elle a été qualifiée de «minimum de la décence». Mais elle n’en demeure pas moins un progrès social d’envergure, qui existe dans tous les pays voisins depuis longtemps. Au Conseil national, la majorité de droite de la commission avait supprimé cette obligation, entraînant le rejet de l’entrée en matière des élus socialistes, qui avaient été suivis par la majorité de la chambre du peuple. Car, dans ces conditions, la suppression sans contrepartie de l’obligation de reprendre tous les salariés en cas de faillite était inacceptable.
Il faut dire que la suppression de cette obligation est une attaque particulièrement dure contre les intérêts des salariés. L’obligation de reprendre tous les salariés lorsqu’on reprend une entreprise est en effet une des garanties majeures du droit du travail, même s’il faut relever qu’une nouvelle jurisprudence du tribunal fédéral en a amoindri la portée. Elle permet d’éviter que le repreneur d’une entreprise ne fasse son «shopping» en sélectionnant les parties rentables de l’entreprise (p. ex. les immeubles ou la propriété intellectuelle) et ne dépèce l’entreprise rachetée sur le dos de ses salariés.
Un bon compromis
Malgré l’atteinte aux droits des salariés, cette révision de la LP peut être à mon avis considérée comme un compromis acceptable, à condition que l’équilibre proposé par le Conseil fédéral (plans sociaux en échange de la suppression de reprise des contrats de travail en cas de faillite) tienne jusqu’au bout. Si le Conseil national devait, sous la pression des milieux patronaux, refuser d’ancrer les plans sociaux dans la législation, les socialiste n’auraient alors pas d’autre choix que de couler définitivement une révision qui serait alors totalement contraire aux intérêts des salariés.

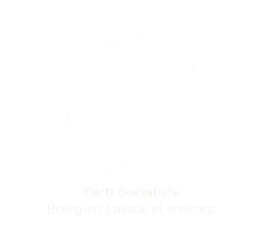
Je suis tout à fait d’accord avec ton message.